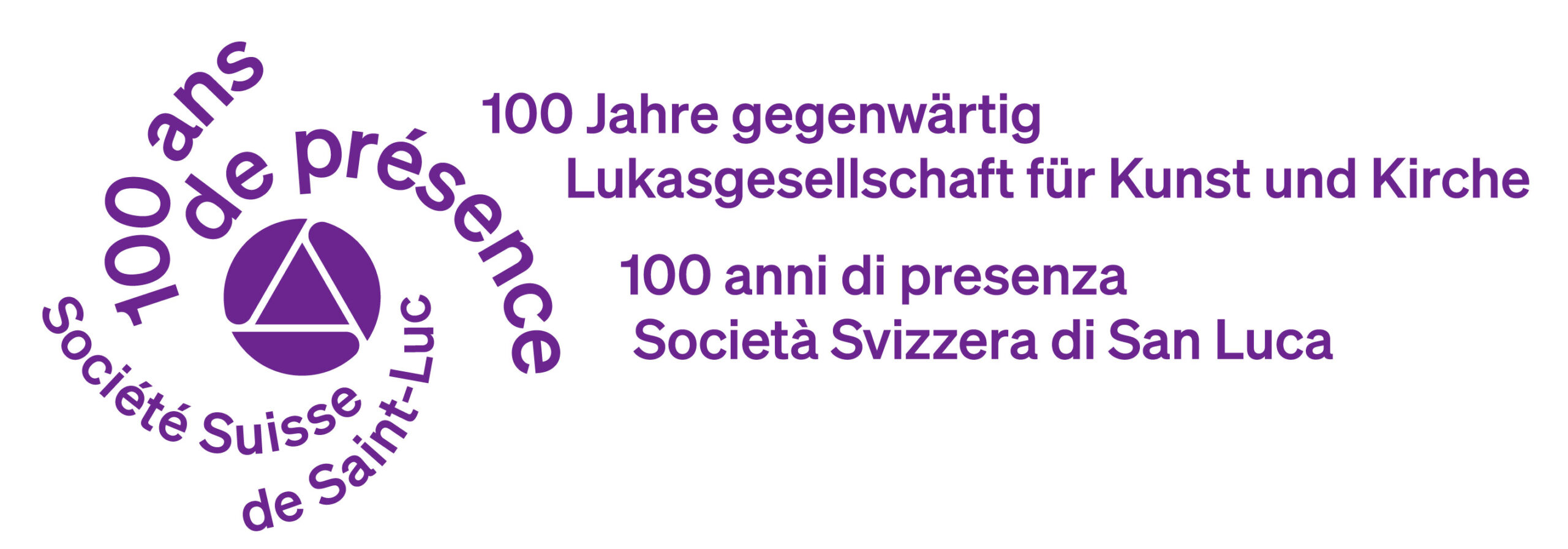

L’histoire de la Société Saint-Luc
Résumé
1919 Les artistes Alexandre Cingria et Marcel Poncet fondent à Genève le «Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice». L’objectif est de «favoriser le développement de l’art religieux et de servir d’intermédiaire entre la clientèle et les artistes“. Le groupe se dissout en 1924.
1924 Suite à une exposition d’art chrétien moderne à Bâle, des membres du groupe romand, ensemble avec des architectes, des artistes et des théologiens de Suisse alémanique, fondent la Société suisse de Saint-Luc/SSL. Ceci dans le but de développer et de promouvoir l’art chrétien actuel. Les membres sont de confession catholique et de nationalité suisse.
1924 – 45 La SSL rejette l’architecture et l’art religieux historicisant et s’engage pour la promotion d’une esthétique contemporaine. Elle est représentée lors d’expositions nationales et internationales. Le conseiller fédéral tessinois Giuseppe Motta, entre autres, en est membre à cette époque.
Le Groupe romand prône la collaboration des arts décoratifs au sein d’un concept architectural global. Cette importance éminente des arts décoratifs contraste nettement avec l’attitude esthétique de la partie germanophone de la société, influencée par le «Neues Bauen».
1932 Les tensions croissantes entre les représentants francophones et les germanophones conduisent à la division en deux groupes régionaux dotés d’une grande autonomie.
Milieu des années 30 à 1950 la Société de Saint-Luc est ancrée dans le «mouvement liturgique» de l’Eglise catholique. L’art doit certes être moderne, mais il doit se comprendre au service de «l’acte sacré» de la liturgie.
1945 A partir de 1945, les activités du groupe romand diminuent continuellement et s’éteignent finalement.
1950 – 1980 Dans l’après-guerre, la Suisse connaît un boom dans la construction d’églises. La Société de Saint-Luc est à son apogée. Son engagement pour une esthétique contemporaine est soutenu par les instances ecclésiastiques. Les architectes et les artistes de la société reçoivent de nombreuses commandes. Le nombre de membres atteint presque 1000 personnes.
1958 Les membres ne sont plus tenus d’être catholiques ni de posséder la nationalité suisse.
1988 – 2000 Dans le dernier quart du XXe siècle, la Société de Saint-Luc connaît un changement : les artistes se distancient de plus en plus du label de l’«art chrétien». L’art est perçu comme autonome et indépendant des institutions ecclésiastiques et étatiques. Désormais, la Société de Saint-Luc s’intéresse aussi à l’art en dehors des églises et des contextes chrétiens. En conséquence, elle organise des expositions qui se veulent des «ponts entre l’art et l’Eglise». A partir de 1988, la société ne se considère plus comme une organisation confessionnelle, mais défend une attitude œcuménique ouverte.
2000 – 2024 Durant cette période, on part de plus en plus d’un dialogue ou d’un discours entre les partenaires d’égale importance que sont l’art et l’église. Différents symposiums sont ainsi organisés pour définir les rapports entre les deux mondes. Les publications de la SSL à cette époque s’appellent «Forum Art et Eglise» (Forum Kunst und Kirche) ou Annuaire Art + Eglise (Jahrbuch Kunst und Kirche).
Au cours des 15 dernières années, on constate une fois de plus une ouverture de la Société de Saint-Luc. Il n’est plus seulement question de dialogue entre l’art et l’église, mais aussi entre l’art et la religion, parfois aussi entre l’art et la spiritualité ou le sacré.
Quellen
- NOVERRAZ Camille. « Le Groupe de Saint-Luc et la SSL : vers l’affirmation d’une identité romande.» Dans GEWAGT! 100 Jahre gegenwärtig. Jahrbuch Kunst + Kirche, Band 2024. Zurich: Theologischer Verlag Zürich, 2024
- STÜCKELBERGER Johannes. «100 Jahre Schweizerische St. Lukasgesellschaft. Ziele, Aufgaben und Themen im Wandel der Zeit.» Dans GEWAGT! 100 Jahre gegenwärtig. Jahrbuch Kunst + Kirche, Band 2024. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2024
Contact et informations : sekretariat@lukasgesellschaft.ch
